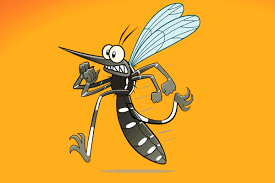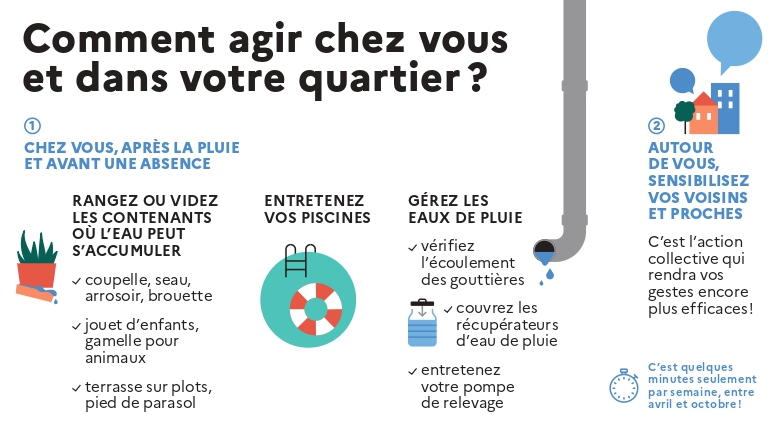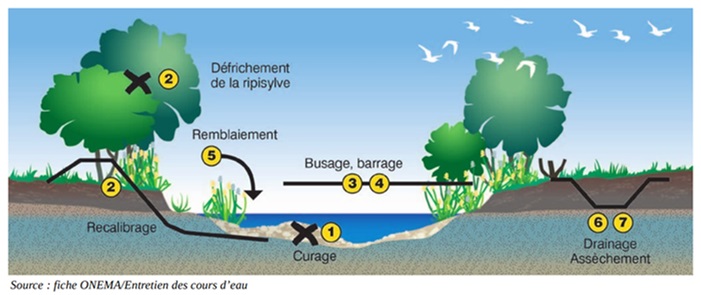Vous, ou vos collègues, êtes élu dans un syndicat de rivière ou un EPCI en charge de la GEMAPI; vous débutez, ou non, sur le sujet et vous recherchez des informations? Des guides existent mais sont-ils suffisants?
En complément des sorties terrains et des éléments que peuvent vous apporter vos agents, cette chaine YouTube vous propose des rendez-vous réguliers et gratuits entre élus pour pouvoir échanger sur les thématiques autour du grand cycle de l‘eau : fonctionnement d’un bassin versant, gestion des inondations, aspects règlementaires…
Le principe est simple: 1 à 3 intervenants volontaires pour exposer un sujet, puis vous, élus, pourrez poser vos questions et partager les réponses; un enregistrement vidéo viendra sauvegarder le tout ! Vous pouvez ainsi devenir acteur en partageant votre expérience ou simplement vos interrogations.